Retour Rey Guillaume — Retour Orient Châteaux
Le Crac des Chevaliers (Kalaat-el-Hosn)
Pendant presque tout le temps de la domination française en Syrie, la frontière orientale des colonies chrétiennes fut formée par la chaîne de montagnes qui s'étend de Tripoli à Antioche. Aussi chaque passage ou chaque point stratégique était-il gardé par une forteresse. C'est là que nous retrouvons presque intacts ces grands châteaux des ordres militaires de l'Hôpital et du Temple, semblant, au milieu de ces régions peu visitées, vouloir témoigner encore de cette glorieuse époque de notre histoire nationale.Sur l'un des sommets dominant le col qui met en communication la vallée de l'Oronte avec le bassin de la Méditerranée, se dresse le Kalaat-el-Hosn. Tel est le nom moderne de la forteresse que nous trouvons désignée par les chroniqueurs des croisades sous celui de Krak ou Crac des Chevaliers, et appelée chez les historiens arabes château des Curdes.
Position militaire de premier ordre en ce qu'elle commande le défilé par lequel passent les routes de Homs et de Hamah à Tripoli et à Tortose, cette place était encore merveilleusement située pour servir de base d'opérations à une armée agissant contre les états des soudans de Hamah.
Le Krak formait, en même temps, avec les châteaux d'Akkar, d'Arcas, du Sarc, de la Colée, de Chaslel-Blanc, d'Areymeh, de Yammour (Chastel-Rouge), Tortose et Markab, ainsi qu'avec les tours et les postes secondaires reliant entre elles ces diverses places, une ligne de défense destinée à protéger le comté de Tripoli contre les incursions des musulmans, restés maîtres de la plus grande partie de la Syrie orientale.
Du haut de ses murs, la vue embrasse, vers l'est, le lac de Homs et une partie du cours de l'Oronte. Au-delà se déroulent, au loin, les immenses plaines du désert de Palmyre. Vers le nord, les montagnes des Ansariés arrêtent le regard, qui, vers l'ouest, s'étend par la vallée Sabbatique, aujourd'hui Nahar-es-Sabte, sur la riche et fertile vallée où furent les villes phéniciennes de Symira, de Carné, d'Amrit, et découvre à l'horizon les flots étincelants de la Méditerranée.
Au sud, les deux chaînes du Liban et de l'Anti-Liban esquissent leurs grands sommets aux fronts couverts de neiges.
Plus près à l'est, comme un tapis de verdure, s'étend, au pied du château, la plaine de la Boukeiah-el-Hosn, la Bochée des chroniqueurs, théâtre d'un combat célèbre dont nous aurons à nous occuper dans le cours de cette étude.
Vers le sud-est, et à environ trois quarts d'heure de distance, sont le village moderne et les ruines de la tour d'Anaz, prise par Malek el-Adel, frère de Salah ed-Din, lors de sa tentative contre le Krak en l'année 1206 (1).
1. Extrait des Historiens Arabes des Croisades, publié par M. Reinaud.
Le village de El-Hosn, situé au pied du château, formait, au moyen Age, un bourg assez considérable entouré de murailles percées de deux portes flanquées de tours; l'une de ces portes s'ouvre à l'occident et l'autre vers l'est.
On y voit encore trois mosquées.
A la plus grande, élevée par Melik en-Naser, était réuni un hôpital pour les musulmans de Ouady-Radïn, fondé en 719 de l'hégire par le gouverneur du Hosn, Bekoum-Ibn-Abdallah el-Ascherafieh. Là aussi se trouvent deux tombeaux, celui de l'émir Sarem ed-Din el-Kafrouri ed-Dhahiri es-Saidi, premier gouverneur du château après sa prise par les musulmans, mort au mois de zilcaade 690 de l'hégire, et celui d'Ali-Kamar ed-Din, mort dans les premières années du VIII siècle de l'hégire.
A peu de distance, sur un tertre, est situé le cimetière, où l'on remarque les tombeaux à coupoles de deux officiers de Bybars : les émirs Nour ed-Din et Boh ed-Din, qui périrent pendant le siège. Un peu plus loin est celui de Scheik-Osman, qui, selon la tradition, était palefrenier de ce sultan, et qui fut tué à côté de lui durant l'une des attaques dirigées contre le château.
Le village se divise en deux quartiers : l'un se nomme Haret el-Turkman, l'autre Haret es-Seraïeh, à cause du palais occupé en dernier lieu par les émirs turcomans de la famille Seifa.
Le relief de la montagne sur laquelle s'élève la forteresse est d'environ 300 mètres au-dessus du fond des vallées, qui, de trois côtés, l'isolant des hauteurs voisines, en forment une espèce de promontoire.
On reconnaît ici le même principe déjà signalé à Margat, et que nous aurons fréquemment, par la suite, l'occasion d'observer sur d'autres points.
Le Kalaat el-Hosn n'est pas une grande habitation féodale fortifiée et destinée à dominer le pays d'alentour, soumis au châtelain, et dont relevaient les fiefs environnants. C'est une place de guerre des plus importantes, possédée par l'un des deux grands ordres militaires, créée ou du moins reconstruite par lui, pour en faire un de ses principaux établissements sur la frontière orientale des provinces chrétiennes.
Nous y trouvons les Hospitaliers, devenus si formidables qu'ils imposaient des tributs aux princes musulmans de Hamah et de Massiad, et promenaient leurs armes victorieuses sur les bords de l'Oronte (1).
1. Continuateur, de Guillaume de Tyr, Livre XXIII, chapitre XXXVIII.
Le Krak est encore à peu près dans l'état où le laissèrent les chevaliers au mois d'avril 1271. A peine quelques créneaux manquent-ils au couronnement de ses murailles et quelques voûtes se sont-elles effondrées; aussi tout ce vaste ensemble a-t-il conservé un aspect imposant qui donne au voyageur une bien grande idée du génie militaire et de la richesse de l'ordre qui l'a élevé.
Le Krak des Chevaliers - Description
Cette forteresse comprend deux enceintes que sépare un large fossé en partie rempli d'eau. La seconde forme réduit et domine la première, dont elle commande tous les ouvrages (pl. VI); elle renferme les dépendances du château : grande salle, chapelle, logis, magasins, etc. Un long passage voûté, d'une défense facile, est la seule entrée de la place. Les remparts et les tours sont formidables sur tous les points où des escarpements ne viennent pas apporter un puissant obstacle à l'assaillant.Au nord et à l'ouest, la première ligne se compose de courtines reliant des tourelles arrondies et couronnées d'une galerie munie d'échauguettes, portées sur des consoles, formant, sur la plus grande partie du pourtour de la forteresse, un véritable hourdage de pierre. Ce couronnement présente une grande analogie avec les premiers parapets munis d'échauguettes qui aient existé en France, où nous les voyons apparaître dans les murailles d'Aigues-Mortes et au château de Montbard en Bourgogne, sous le règne de Philippe le Hardi (2). Mais au Kalaat el-Hosn,il est impossible de ne pas leur assigner une date antérieure, le château étant tombé entre les mains des musulmans en l'an 1271.
2. Viollet-le-Duc, Dictionnaire d'architecture, tome VI, page 202.
Au-dessus de ce premier rang de défenses s'étend une banquette bordée d'un parapet crénelé avec meurtrières au centre de chaque merlon. Ici nous retrouvons un usage généralement suivi en Europe dans les constructions militaires durant le XIIe et le XIIIe siècle : les tourelles dominent la courtine, et des escaliers de quelques marches conduisent des chemins de ronde sur les plates-formes.
Chaque tour renferme une salle éclairée par des meurtrières, et dans les courtines s'ouvrent à des intervalles réguliers de grandes niches voûtées en tiers-point, au fond desquelles sont percées de hautes archères destinées à recevoir des arbalètes à treuils ou d'autres engins de guerre du même genre.
Plan de M. Rey

Figure 9
La tourelle « A », qui se trouve à l'angle nord-ouest de la première enceinte, est surmontée d'une construction arrondie d'environ 4 mètres de hauteur. Ce fut, selon toute apparence, la base d'un moulin à vent, si nous en jugeons par le nom moderne, Bordj el-Tahouneh (la tour du moulin), ainsi que par les corbeaux sur lesquels s'appuyaient les potelets et les liens supportant cet ouvrage qui devait être en charpente, comme on pourra le voir par la planche VII, où nous l'avons restitué sur les indications de M. Viollet-le-Duc.
Le sud étant le point le plus vulnérable de la place, c'est là qu'ont été élevés les principaux ouvrages, et c'est surtout dans les tours d'angles et à la tour carrée placée dans l'axe du château en « A » qu'on s'est efforcé de disposer les défenses les plus importantes. Aussi ces tours sont-elles bâties sur des proportions beaucoup plus considérables que les autres, et tous les moyens de résistance s'y trouvent-ils accumulés.
Bien que séparée de la seconde enceinte par le fossé « B », rempli d'eau, cette première ligne en est assez rapprochée pour être sous la protection des ouvrages « I — J — K », qui la dominent, de telle sorte qu'au moment de l'attaque les défenseurs du réduit pouvaient prendre part au combat.
Je vais maintenant décrire sommairement la tour « A », dont je donne ici le plan (fig. 10).
Plan de M. Rey
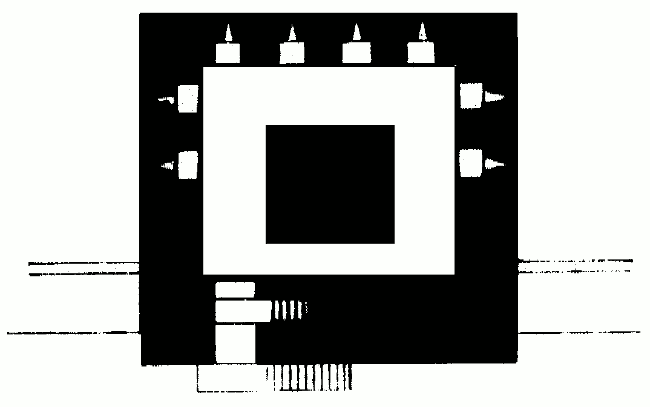
Figure 10
Plan de M. Rey
Huit meurtrières éclairent cette salle (figure 11).
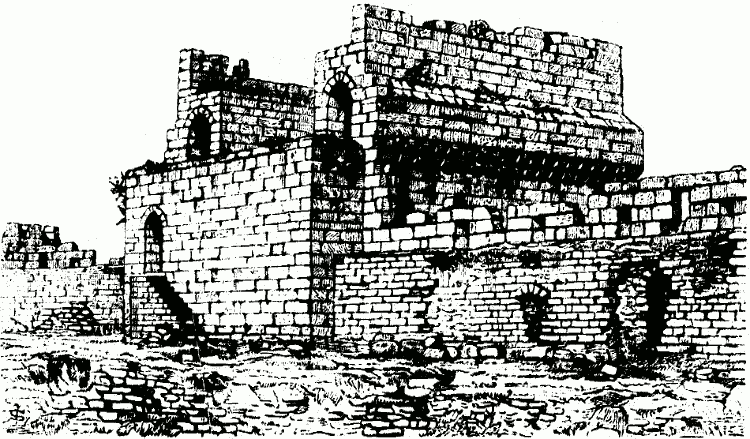
Figure 11
1. Je donne le texte de ces trois inscriptions dans les notes placées à la fin de ce volume.
On avait d'ailleurs multiplié les obstacles de ce côté, car outre le fossé « B », aujourd'hui comblé, nous trouvons encore en « C » les traces d'un ouvrage avancé, probablement un palis qui fut lui-même entouré d'un fossé jadis rempli d'eau, à en juger par l'existence d'un barrage vers l'extrémité est, là où commence la déclivité de la montagne. L'eau devait être amenée dans ces fossés par l'aqueduc qui alimente l'abreuvoir qu'on trouve entre les deux enceintes du château.
La partie orientale des remparts est moins bien conservée ; les parapets sont dérasés dans plus de la moitié de leur hauteur; cependant les échauguettes sont encore en place ; elles sont plus petites ici que sur les autres faces de la forteresse et ne sont supportées que par deux consoles. Trois saillants carrés d'un relief assez faible flanquent cette muraille, qui est d'ailleurs mise à l'abri de toute attaque sérieuse par l'escarpement de la montagne.
C'est de ce côté que s'ouvre en « C » l'entrée du château, dans lequel on pénètre par une porte ogivale au-dessus de laquelle se lit l'inscription, aujourd'hui mutilée, qu'y fit graver le sultan Malek ed-Daher-Baybars après le siège qui mit le Krak en son pouvoir :
Au nom du Dieu clément et miséricordieux.
La restauration de ce château fort béni a été ordonnée sous le règne de notre maître le sultan, le roi puissant, le victorieux, le juste, le défenseur de la foi, le guerrier assisté de Dieu, le conquérant favorisé de la victoire, la pierre angulaire du monde et de la religion, le père de la victoire, Baybars l'associé de l'émir des croyants, et cela à la date du jour de mercredi........
Armoiries de Baybars
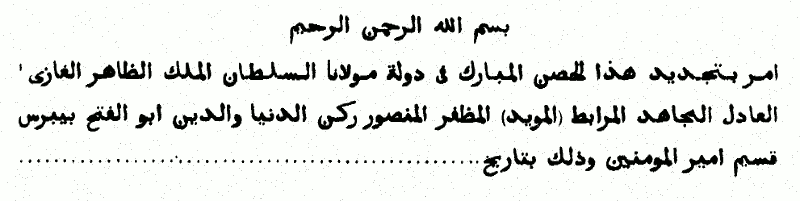
1. A droite et à gauche de la seconde ligne de cette inscription se voient sculptés deux lions marchant à droite (armoiries de Baybars).
Le plan ci-joint en rendra la description plus claire (fig. 12).
Plan de M. Rey
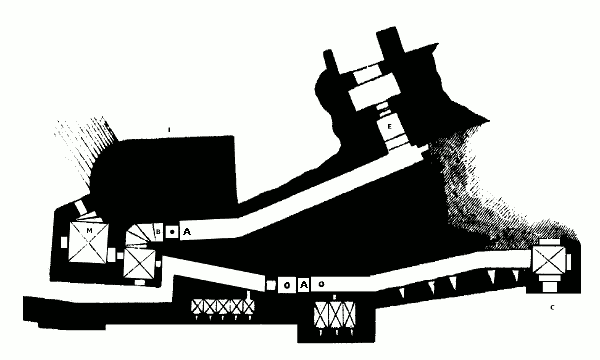
Figure 12
En « B », cette rampe franchit à ciel ouvert le terre-plein de la première enceinte avec laquelle elle communique sous le commandement de la tour « I », puis, tournant alors brusquement sur elle-même, elle s'engage dans une seconde galerie ménagée sous l'ouvrage « C ». Une troisième porte « D », également munie d'un mâchicoulis, ferme l'entrée de cette galerie, qui, de la sorte, se trouve comprise dans la seconde enceinte et se prolonge jusqu'à la partie supérieure du château dont l'entrée s'ouvre à gauche en « E ». Une herse et des vantaux fermaient jadis cette dernière porte, en avant de laquelle se trouve un grand mâchicoulis carré, semblable à celui qu'on voit à la porte narbonnaise de la cité de Carcassonne, et qui, par ses dimensions extraordinaires, permettait aux assiégés de lancer des projectiles non-seulement au milieu, mais encore contre les parois du passage s'étendant jusqu'à la galerie.
Quand le visiteur a franchi le seuil, il est frappé de l'aspect imposant d'ailleurs, mais d'une majesté triste, que présente l'intérieur désert de la forteresse. Un morne silence y a remplacé l'animation et le tumulte des gens de guerre, et au milieu de ces grands restes d'un passé glorieux, l'oeil rencontre partout des décombres.
A droite, en « D » (plan IV), se trouve d'abord un vestibule voûté communiquant avec la chapelle, qui paraît dater de la fin du XIIe siècle. C'est une nef terminée par une abside arrondie percée d'une petite baie ogivale. Les proportions de cet édifice sont moins grandes qu'à Margat. Il mesure dans oeuvre 21 mètres de long sur 8,40 mètres de large, et sa voûte en berceau est divisée en quatre travées par des arcs doubleaux chanfreinés retombant sur des pilastres engagés. On reconnaît encore ici une production de ces mêmes artistes formés à l'école d'où sortaient les architectes qui élevèrent les églises de Cluny, de Vézelay et la cathédrale d'Autun.
A l'intérieur, une moulure fort simple règne à la naissance des voûtes et détermine le sommet des pilastres. Le portail est ogival, son ornementation est des plus sobres et consiste en une double ligne de billettes et de bâtons rompus; il est condamné par un escalier d'une construction évidemment postérieure, bien qu'encore de l'époque française.
Plan de M. Rey
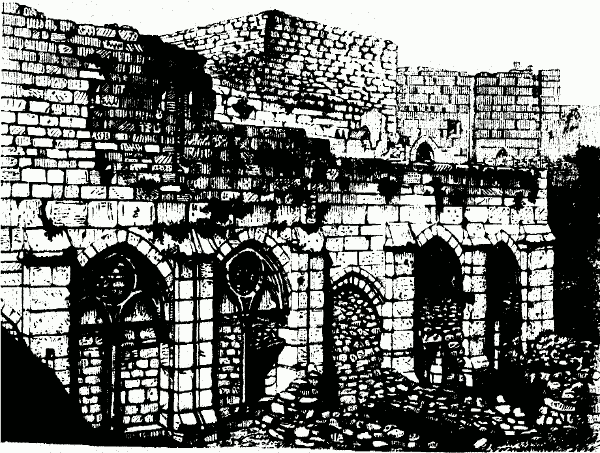
Figure 13
Un deux, espèce de logogriphe que je me borne à transcrire, me parait pouvoir trouver ici sa place.
Ullinia sit prima
Sit prima secunda
Sit una in medio posita
Nomen habebit ita.
De l'autre côté de la cour et presque en face de la chapelle est la grande salle, élégante construction paraissant dater du milieu du XIIIe siècle. Sur toute la longueur règne une galerie en forme de cloître, composée de six petites travées; quatre sont fermées par des arcatures à meneaux d'un fort beau style (figure 13). Les archivoltes des deux petites portes qui font communiquer la grande salle avec cette galerie sont ornées de riches moulures, retombant de chaque côté sur deux colonnettes, et dans les linteaux monolithes qui les soutiennent se voient des restes d'écussons malheureusement mutilés aujourd'hui.
Quant à la salle proprement dite, elle comprend trois grandes travées et mesure en oeuvre 25 mètres de long sur une largeur de 7 mètres. Les arcs doubleaux et ogives, dont je donne les profils figure 14, retombent sur des consoles ornées de feuillages et de figures fantastiques, et l'on pourra y remarquer déjà le petit filet saillant sur les boudins que l'on observe en France vers cette même époque.
Plan de M. Rey
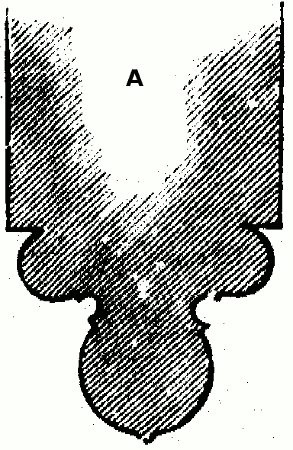
Figure-14-A
Plan de M. Rey
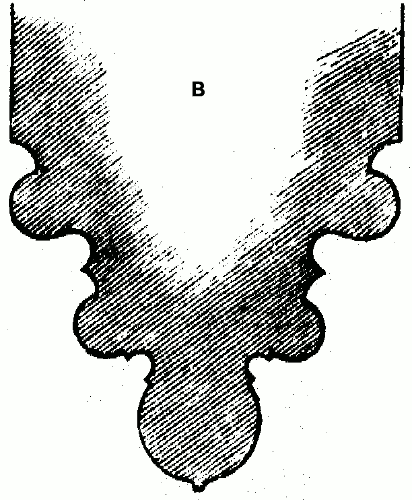
Figure-14-B
Une grande fenêtre surmontée de roses au nord, une semblable au sud, ainsi que deux fenêtres ogivales s'ouvrant dans la face orientale de l'édifice, éclairaient l'intérieur de ce vaisseau.
Tout cet ensemble, très-soigné dans tous les détails de la construction, permet par son ornementation d'attribuer une date à son érection.
On remarque également dans les contreforts de l'édifice les entailles des descentes destinées à conduire les eaux pluviales dans une citerne qui existe sous la cour.
Sur le côté de l'un des contreforts du porche se lisent les vers suivants gravés en beaux caractères, que leur forme me porte à attribuer au milieu du XIII siècle :
Plan de M. Rey
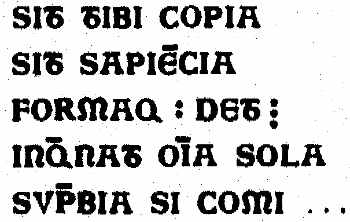
Figure-14-C - Sit tibi copia, sit sapientia, formaque detur;
Inquinat omnia sola superbia, si cornitetur.
Dans les chartes de cession des fiefs de Margat et du Krak, l'ordre, déjà si puissant alors, est simplement désigné sous la modeste appellation de Maison des pauvres de Jérusalem.
Au nord des deux édifices que je viens de décrire, de vastes magasins ou des écuries obstrués aujourd'hui de débris de toutes sortes règnent sous les remparts; on y entrait par plusieurs grandes arcades qui se voient dans la coupe (planche V).
Un escalier à pente très-douce amène au niveau de la cour supérieure « E », sous laquelle s'étendent de grandes caves, également remplies d'immondices de manière à en rendre la reconnaissance à peu près impossible au-delà d'un certain point.
Le visiteur trouve à sa droite dans cette cour une plate-forme en pierre de taille « F » s'élevant d'un pied environ et qui semble avoir été une aire à battre le grain. A gauche sont des bâtiments « G » paraissant avoir servi de casernement pour la garnison, et au milieu desquels se voient encore, au-dessus de l'entrée de la seconde enceinte, en « G », les arrachements d'une tour carrée, aujourd'hui presque entièrement ruinée, mais qui, jadis, flanquait cette face du réduit. Son tracé est indiqué au pointillé (plan IV), et nous avons cru devoir la rétablir dans la restauration vue à vol d'oiseau que nous donnons du Krak (plan VII). En « H », le long de la courtine occidentale, se voit une galerie crénelée sur laquelle règne le chemin de ronde. Au pied sont des ruines que je crois avoir été des écuries ou qui du moins présentent une grande analogie avec celles qui existent encore au château de Carcassonne. A l'extrémité méridionale de cette esplanade se voient les tours, dont il me reste à parler. Ce sont les plus élevées de toutes les défenses du château dont elles commandent les approches (figure 15).
Plan de M. Rey
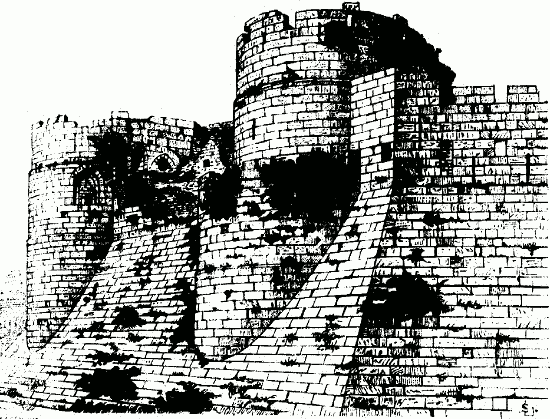
Figure 15
Plan de M. Rey
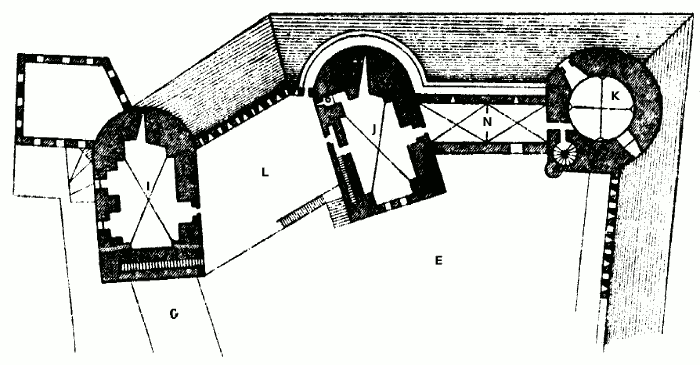
Figure 16
1. Cet ouvrage parait avoir été destiné à couvrir la rampe (figure 12) à son débouché sur le terre-plein de la première enceinte. Il est construit en blocs de grand appareil, avec bossages tout à fait indépendants des joints de la pierre; ces derniers sont taillés avec soin et les joints sont chanfreinés.
Plan de M. Rey
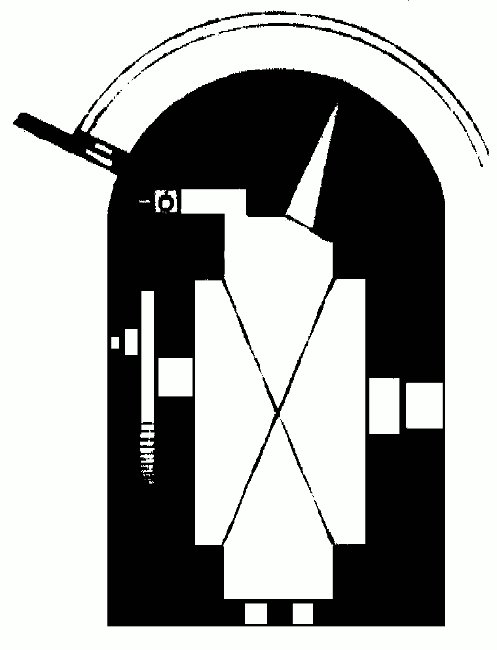
Figure 17
Cette pièce est éclairée sur la cour par des fenêtres à doubles baies, séparées par un meneau central supportant un linteau décoré d'arcatures avec fleurons au milieu du tympan et semblables à celles que nous trouvons en France dans les constructions civiles du commencement du XIIIe siècle.
L'escalier de la plate-forme a été réservé dans l'épaisseur du mur oriental. Une seule meurtrière, de grande proportion, est percée à chaque étage vers les dehors de la place. Des latrines sont ménagées dans l'épaisseur du mur. Par la porte aujourd'hui murée on passait dans un vaste logis « N », maintenant ruiné, reliant la tour dont je viens de parler à celle de l'angle occidental, où l'on voit encore à l'étage supérieur une salle ronde éclairée par deux fenêtres ogivales et décorée avec élégance. Quatre colonnettes engagées supportent les nervures de la voûte, et une riche moulure forme corniche à la naissance de celle-ci. Cette pièce fut probablement la chambre du châtelain, ou l'appartement réservé au grand maître des Hospitaliers, qui résidait souvent au Krak. Nous possédons des diplômes et des chartes souscrites par plusieurs d'entre eux in castro Crati (1). Un escalier à vis conduit au sommet de cette tour, qui parait avoir été surmontée d'un mât de pavillon dont la base existe encore. Sur les murs de cette partie du château j'ai relevé les signes suivants, gravés à la pointe par les appareilleurs au moment de la construction.
Plan de M. Rey
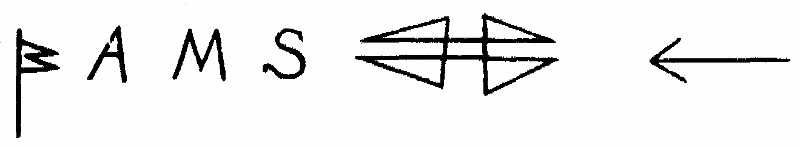
Figure 17 A
Au pied de ces défenses s'étendent de gigantesques talus en maçonnerie, ayant à la fois pour objet de les prémunir contre l'effet des tremblements de terre, et, en cas de siège, d'arrêter les travaux des mineurs. Dans sa relation du siège du Krak par Bybars, l'historien Ibn-Ferat désigne le réduit qui nous occupe en ce moment sous le nom de la colline, peignant ainsi son escarpement (figure 18).
Plan de M. Rey
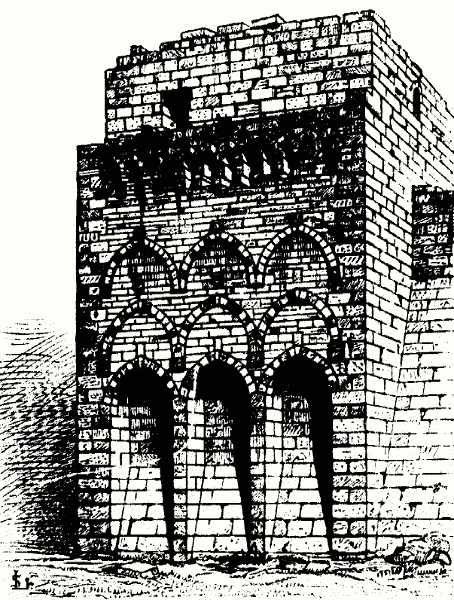
Figure 18
Ici, comme dans tous les châteaux où la garnison avait à garder une double enceinte, il fallait rendre les communications entre les deux parties assez faciles pour que, en cas de besoin, on pût se porter rapidement au secours du point menacé. C'est pourquoi deux poternes avaient été percées dans des angles rentrants du réduit où elles étaient dissimulées. La première s'ouvre au bout de la grande rampe, à l'angle de l'ouvrage « C », et de la courtine qui le rattache à la chapelle et sous le commandement de la tour qui s'élevait en « G », la seconde, dans la base de la tour « P », sous le mâchicoulis qui se voit à l'est. Un large contrefort prolonge de ce côté la façade de l'ouvrage et ne paraît pas avoir eu d'autre but que celui de masquer cette poterne, dont aucun indice ne fait soupçonner l'existence à quiconque pénètre pour la première fois dans les murs du Krak (figure 19).
Plan de M. Rey
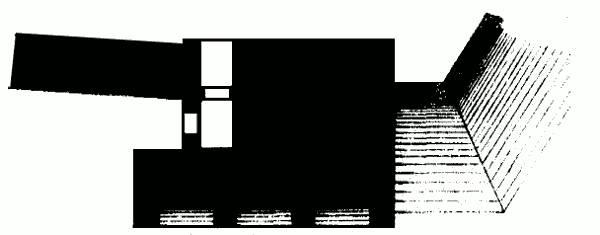
Figure 19
Selon toute apparence, elles doivent être alimentées par l'aqueduc qui amène l'eau dans le fossé « B ».
Arrivé au terme de la description de cette forteresse, je vais tenter d'en esquisser l'histoire aussi brièvement que possible.
Les divers auteurs, tant chrétiens qu'arabes, qui ont écrit l'histoire des croisades parlent fréquemment de ce château, nommé par les premiers Krak et par les seconds Hosn-el-Akrad. Ce nom paraît assez identique à celui de l'appellation franque, qui pourrait bien n'être qu'une corruption du mot arabe Akrad, Kurde (1).
1 En Syrie plusieurs forteresses portent le nom de Krak ou Karak, ce sont le Krak des Chevaliers, le Krak de Montréal et le Krak ou Petra deserti; ce nom est encore porté par plusieurs villages bâtis sur des tertres. D'après M. de Quatremère (2), ce nom aurait eu pour étymologie le nom syriaque « Lolo » (forteresse). M. de Vogué (3) est du même avis en proposant pour origine de ce nom le mot hébraïque, signifiant lieu fermé ou fort, opinion que confirment d'ailleurs plusieurs passages de Denys d'Halicarnasse.
2. Traduction de Makrizi, tome II, Appendice, page 236.
3. Inscriptions araméenne de Palmyre et de la Syrie orientale, page 11.
Quelques écrivains, entre autres Carl Ritter; ont cru retrouver ici le site de Mariamme.
En l'année 1102, le comte de Saint-Gilles, après s'être emparé de Tortose, entreprit le siège du château des Kurdes. Le soudan de Hamah, Djenah-ed-Dauleh, se préparait à marcher contre lui. lorsque, se rendant à la mosquée, il fut poignardé par un Ismaélien. Cette nouvelle inattendue détermina le comte de Saint-Gilles à profiter du trouble causé par cet événement, et il se porta sur Hamah, dont il ravagea le territoire sans pouvoir toutefois prendre la ville (1).
1. Aboul Féda, extrait des Historiens Arabes des Croisades, publiés par M. Reinaud, page 272.
Cet incident lui ayant fait lever sans retard le siège du Krak, nous ignorons à quelle époque les Francs occupèrent cette forteresse. Cependant, d'après le texte d'Ibn-Ferat, nous avons tout lieu de penser que ce fut vers l'année 1125.
Voici ce que l'historien arabe Lakout nous apprend sur ce château ainsi que sur l'origine de son nom :
« La forteresse de Hosn-el-Akrad est un château d'une force remarquable, s'élevant sur la montagne qui fait face à Homs vers l'occident. Cette montagne se nomme le Djebel-Halil et se rattache à la chaîne du mont Liban. »
« Dans l'origine, ce ne fut qu'une tour construite par un gouverneur de Damas qui y établit une garnison de Kurdes, auxquels les terres environnantes furent abandonnées pour eux et leurs familles, à charge de garder ce passage et de surveiller les mouvements des Francs, Pour se mettre à l'abri de leurs tentatives, on augmenta peu à peu les fortifications de cette place, qui devint de la sorte une forteresse très-importante. Elle entrava beaucoup d'expéditions des Francs, mais elle fut abandonnée par les Kurdes, qui retournèrent dans leur pays. Les Francs s'en emparèrent alors, et tous les efforts du prince de Homs ont été impuissants à la leur enlever. »
Depuis sa prise par les croisés, ce château parait avoir été un simple fief dont le nom était porté par ses possesseurs jusqu'à l'année 1145 (2), époque à laquelle Raimond, comte de Tripoli, le concéda à l'Hôpital, ainsi que plusieurs autres châteaux.
2. Voir le texte de cette charte aux pièces justificatives.
Qu'était le château à cette époque ? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre; nous savons seulement que cette forteresse eut beaucoup à souffrir de divers tremblements de terre, particulièrement en 1157 (1), 1169 et 1202. Il est donc à présumer que ce fut à la suite de celui de 1202 que le Kalaat-el-Hosn dut être reconstruit à peu près entièrement et tel que nous le voyons aujourd'hui.
1. Aboul Féda, extrait des Historiens Arabes des Croisades, publiés par M. Reinaud, page 267-307. - Livre Les Deux Jardins, page 574.
Après sa cession aux Hospitaliers, le gouvernement du Krak fut confié à des châtelains de l'ordre.
Voici la liste de ceux dont les noms sont parvenus jusqu'à nous :
Ermanus ----------------- 1185
Pierre de Vallis -------- 1186 (2)
Pierre de Mirusande ----- 1198 (3)
Geoffroi ---------------- 1204 (4)
Arnaud de Montbrun ------ 1241
Hugues de Revel --------- 1243 (5)
Jean de Bubi ------------ 1248
Aimar de la Roche ------- 1253 (6)
2. Codice Diplomatico n° 77, pages 78-79.
3. Codice Diplomatico n° 211, page 252.
4. Codice Diplomatico n° 87, page 93.
5. Codice Diplomatico n° 179, page 202.
6. Codice Diplomatico n° 121, pages 138-145.
Nous savons par le récit de Vilbrand d'Oldenbourg que la forteresse qui nous occupe était habituellement gardée par 3,000 combattants (7).
7. Laurent Medii avi periginatores quatuor, page 169. Leipsick, 1864.
Durant l'année 558 de l'hégire, 1163 de notre ère, Nour-ed-din, soudan d'Alep et fils aîné d'Amad-ed-din-Zenghi, essuya sous les murs du Krak une sanglante défaite qui a pris dans l'histoire le nom de la journée de la Bokeiah. A ce sujet, l'historien arabe lbn-al-Athir nous apprend ce qui suit :
Nour-ed-Din ayant rassemblé une nombreuse armée, envahit les terres des Francs et vint camper dans la plaine de la Bokeiah, au-dessous du château des Kurdes, qu'il se proposait d'assiéger, comptant, dès qu'il s'en serait rendu maître, se porter sur Tripoli, dont il méditait la conquête. Un jour, vers midi, tandis que les soldats accablés par la chaleur reposaient sous leurs tentes, on aperçut tout à coup la croix des Francs qui venait d'apparaître au sommet de la montagne sur laquelle s'élevait le château. Les Francs, ayant réuni toutes leurs forces, fondaient ainsi à l'improviste sur l'armée musulmane. Les avant-postes tentèrent vainement de résister et firent prévenir Nour-ed-Din. Avant même que le Soudan eût pu être prévenu de l'attaque, déjà ses avant-postes étaient rejetés sur le gros de l'armée et poursuivis l'épée dans les reins. Ils arrivèrent ainsi au quartier de Nour-ed-Din, dont les troupes, n'ayant eu le temps ni de prendre les armes, ni de monter à cheval, furent en partie massacrées, le reste fait prisonnier. Le soudan, à demi vêtu, s'échappa de sa tente et s'élança sur un cheval. Il ne dut son salut qu'au dévouement d'un Kurde qui se fit tuer en coupant l'entrave qui retenait sa monture. Le plus acharné à la poursuite des musulmans fut le Grec Ducas, chef des Grecs auxiliaires au service des Francs. Nour-ed-Din dirigea sa fuite vers les bords du lac de Homs, où il s'arrêta à quatre parasanges (1) du lieu où s'était livré le combat. Ce fut là que vinrent se grouper autour de lui les débris de son armée.
1. C'est-à-dire à 22 kilomètres environ, si on adopte le parassange persan qui correspond à 5,565 mètres.
La garnison chrétienne qui occupait la forteresse ne cessait de faire des courses sur le territoire voisin des princes musulmans. En 1169, le gouverneur du Krak périt durant une de ces incursions, dans un combat livré à l'émir Scheab-ed-Din-Mohammed, près du village de Liboueh, situé aux environs de Baalbeck. Comme ce fait n'est relaté que par les historiens arabes, il m'a été impossible de savoir le nom de ce chevalier.
D'après Ibn-Moncad, Nour-ed-din, loin de se sentir découragé par la défaite qu'il venait d'essuyer, n'aspirait qu'à s'emparer du château sous les murs duquel il avait éprouvé un aussi sanglant échec. Ne se fiant donc plus à la seule chance des armes, il eut recours à la trahison, et dans ce but séduisit un des turcoples de l'Hôpital; mais il échoua encore dans son entreprise, ses propres soldats ayant tué le traître dès la première attaque.
A la suite du désastre de Hattin, qui amena la chute du royaume de Jérusalem, Salah-ed-din vint camper dans la Bochée et tint la forteresse assiégée pendant qu'il ravageait le territoire du comté de Tripoli et qu'il effectuait la reconnaissance de cette place, ce qui empêcha les Hospitaliers de secourir la forteresse d'Archasas, défendue par les chevaliers du Temple.
Lors de la croisade de Philippe-Auguste, la garnison du krak, de concert avec les troupes du comte de Tripoli, tenta une expédition contre Homs, mais elle demeura sans résultat, celle ville ayant été secourue par le Soudan d'Alep.
A la première nouvelle du péril, Seïf-ed-din-Aboubekr-Mohammed-Melek-el-Adel, frère de Salah-ed-din, à la tête de dix mille hommes de cavalerie, vint camper au bord du lac de Homs et se prépara à se porter sur Tripoli. Il s'avança alors vers le Krak et échoua dans l'attaque qu'il dirigea contre ce château. Il ne réussit qu'à s'emparer d'une de ses dépendances, la tour d'Anaz, dont les ruines, qui se voient à deux kilomètres à l'est du Kalaat-el-Hosn, portent encore aujourd'hui le nom de Bordj-Anaz. Il fit prisonniers cinq cents hommes environ formant la garnison de la tour et y trouva également une assez grande quantité d'armes et des munitions qui y avaient été réunies (1). Mais le prince dut se contenter de ce faible avantage remporté pendant sa campagne, car le sort des armes lui fut encore défavorable devant Tripoli, dont il dut lever le siège.
1. Aboul Féda, extrait des Historiens Arabes des Croisades, publiés par M. Reinaud, page 343.
Tripoli, le Krak, Chastel-Blanc, Tortose, Margat et Antioche furent exclus du traité signé entre l'empereur Frédéric II et Malek-el-Kamel. Aussi, dans une bulle adressée au roi de France Louis IX, le 18 juin 1229, par le pape Grégoire IX, ce dernier se plaint-il de voir ces places à la merci des infidèles, par suite de leur exception de la trêve.
Durant le XIIIe siècle, le château qui nous occupe fut appelé à jouer un rôle important dans les événements militaires qui s'accomplirent alors en Syrie. C'était le point de départ et la base d'opérations des Hospitaliers dans leurs expéditions contre les soudans de Hamah qu'ils rendirent tributaires.
Cette ville, ainsi que plusieurs autres, avait été donnée par Salah-ed-din à son neveu Takied-din-Omar, et les descendants de ce dernier en étaient encore maîtres, lorsque Malek-Moudafer-Mahmoud, fils aîné de Malek-Mansour, qui venait d'être proclamé en 1233, refusa de payer aux Hospitaliers un tribut dont il prétendait s'affranchir. Le Krak vit alors se préparer dans ses murs une expédition dont le continuateur de Guillaume de Tyr (1) nous a laissé une relation assez détaillée qui ne sera peut-être pas dépourvue d'intérêt et que nous allons essayer de résumer ici.
1. Continuateur de Guillaume de Tyr, livre XXXIII, chapitre XXXVIII.
La trêve ayant été rompue, les Hospitaliers réunirent au Krak toutes les forces dont ils purent disposer, tant en Syrie qu'à Chypre. On y voyait Armand de Périgord, maître du Temple, avec tout son couvent; Jean d'Ibelin, le sire de Baruth et cent chevaliers chypriotes; Gauthier, comte de Brienne, avec quatre-vingts chevaliers du royaume de Jérusalem; Pierre d'Avallon, neveu d'Ode de Montbéliard, et beaucoup d'autres chevaliers en renom. Toute cette armée vint camper dans la Bochée, et après y être restée deux jours elle se porta sur Mont-Ferrand, abandonné par ses habitants, qui avaient fui à l'approche des Francs, laissant toutes les rues du bourg barricadées. Après l'avoir détruit, les troupes chrétiennes allèrent dresser leurs tentes à deux lieues de là à un casal nommé Merdjmin, et elles y demeurèrent durant deux jours, ce qui suffit pour porter aux environs le pillage et la dévastation. Etant revenues à Mont-Ferrand, elles furent camper à un autre casal du nom de Samaquie, et le lendemain elles revinrent se cantonner dans la Bochée après huit jours de campagne.
Une bulle du pape Alexandre IV, du 8 avril 1255, exempta les Hospitaliers des dîmes pour tous les biens qu'ils possédaient aux environs du Krak, et douze ans plus tard les dîmes des entrées dues à l'église de Tortose furent remises à l'ordre (1) par Guillaume, évêque de cette ville, moyennant une redevance de mille besants d'or (2).
1. Codice Diplomatico, n° 145, pages 183, 184.
2. 10.500 francs de notre monnaie en 1950.
Makrizi nous apprend que, dans le cours de cette même année 1267, les Hospitaliers conclurent avec le sultan Malek-Daher-Bybars, pour le Krak et pour Margat, une trêve de dix ans dix mois dix jours et dix heures; mais ils durent en même temps renoncer au tribut de quatre mille écus d'or que leur payait le prince de Hamah, à celui de huit cents écus imposés au prince de Bouktys, ainsi qu'aux douze cents écus d'or et aux cent mesures de blé et d'orge qu'ils recevaient de la terre des Assassins.
Si l'ordre, naguère encore puissant, acceptait des conditions aussi dures, c'est que les revers nouvellement essuyés par les Francs de Syrie rendaient sa position chaque jour plus précaire. Durant les dernières années que les chevaliers demeurèrent en possession du krak ils paraissent y avoir été pour ainsi dire bloqués, à en juger du moins par le récit suivant, emprunté à l'historien arabe Makrizi.
Il raconte en ces termes la reconnaissance du château, opérée par Malek-ed-Daher-Bybars-el-Bendoukdar : « Le troisième jour du mois de djoumazi-el-akkar, 668 de l'hégire (1270 de notre ère), le sultan, à la tête de deux cents cavaliers, poussa jusqu'à Hosn-el-Akrad et de là gravit, avec quarante hommes seulement, la montagne sur laquelle est situé le château. Une troupe de Francs qui se trouvait à l'intérieur sortit en armes, mais le sultan les chargea, en tua quelques-uns, mit le reste en fuite, et les poursuivit jusqu'aux fossés de la place en les raillant sur leur retraite. »
Les Francs, malgré tant d'événements désastreux, étaient encore soutenus par l'espérance du succès de la seconde expédition de saint Louis, quand l'année 1271 s'ouvrit pour eux sous les plus tristes auspices : ils apprirent à la fois l'échec de la croisade et la mort du roi de France sur la plage de Tunis.
C'était la dernière chance de salut qui venait de leur échapper, et les musulmans allaient pouvoir réunir toutes leurs forces pour accabler et anéantir les dernier débris de ces colonies chrétiennes de Syrie, qui, pendant une durée d'un peu moins de deux siècles, avaient supporté le choc de toutes les forces de l'Asie. Maintenant elles succombaient, malgré les efforts prodigieux, mais dépourvus d'ensemble, tentés par l'Europe pour soutenir les successeurs de Godefroy de Bouillon.
Ce fut donc dans les premiers mois de 1271 que le Krak devait tomber entre les mains victorieuses du sultan d'Egypte.
Voici, au sujet de ce siège, la relation que nous trouvons dans un auteur contemporain : « Le deuxième jour du mois de djoumazi-el-akkar, le sultan partit du Caire accompagné de son fils le prince Melik-es-Saïd. Il se dirigea vers la Syrie et entra à Damas le huitième jour de redjeb, puis il marcha sur Tripoli et fit prisonniers tous les ennemis qu'il trouva sur sa route. Il étendit ses ravages jusqu'à Safita, qui se rendit et fut évacué par les Francs. Il en sortit sept cents hommes, sans compter les femmes et les enfants.
Les châteaux et les tours qui sont aux environs de Hosn-el-Akrad se rendirent aussi. »
Nous lisons également dans Ibn-Ferat que le 9 de redjeb « le sultan arriva devant Hosn-el-Akrad, le 20 les faubourgs du château furent pris et le Soudan de Hamah, Melik-el-Mansour, arriva avec son armée. Le sultan alla à sa rencontre, mit pied à terre et marcha sous ses étendards. L'émir Seïf-Eddin, prince de Sahyoun, et Nedjem-ed-din, chef des Ismaéliens, vinrent aussi les rejoindre. Dans les derniers jours de redjeb, les machines furent dressées. Le 7 de chaaban, le bachourieh (ouvrage avancé) fut pris de vive force. On fit une place pour le sultan, de laquelle il lançait des flèches. Il distribua de l'argent et des robes d'honneur. Le 16 de chaaban, une des tours fut rompue, les musulmans firent une attaque, montèrent au château et s'en emparèrent. Les Francs se retirèrent sur le sommet de la colline ou du château; d'autres Francs et des chrétiens furent amenés en présence du sultan, qui les mit en liberté par amour pour son fils. On amena des machines dans la forteresse et on les dressa contre la colline. En même temps le sultan écrivit une lettre supposée au nom du commandant des Francs à Tripoli, adressée à ceux qui étaient dans le château et par laquelle il leur ordonnait de le livrer. Ils demandèrent alors à capituler. On accorda la vie sauve à la garnison, sous condition de retourner en Europe. »
Les Francs ayant évacué le Krak le 8 avril 1271, le même auteur nous apprend encore que le sultan en nomma gouverneur l'émir Sarim-ed-din-el-Kafrouri et donna des ordres pour réparer la forteresse. Durant le séjour qu'il y fit, il reçut une députation du seigneur de Tortose (c'était probablement le commandeur du Temple qui est désigné sous ce titre) venant lui demander la paix. Elle fut conclue pour Tortose seulement, mais Safita et son territoire, étant tombés au pouvoir du sultan, ne furent pas compris dans le traité. Il fut stipulé, en outre, qu'on restituerait tout ce qui avait été pillé pendant le règne de Malek-en-Naser, et que toute espèce de prétention sur les pays de l'islamisme serait abandonnée par les chrétiens.
Il fut encore signifié que le pays et les revenus de Markab seraient également partagés entre le sultan et les Hospitaliers, auxquels il concédait le droit de restaurer le château. Les Francs remirent plusieurs autres châteaux au sultan, et c'est à ces conditions que la paix fut signée.
Outre l'exagération dont sont empreints les passages que nous venons de citer, il y a lieu de remarquer qu'il s'y est, selon toute apparence, glissé une erreur sur la durée du siège de la forteresse.
D'après l'historien Marino Sanuto, il faudrait fixer au 18 février 1271 l'arrivée de Bybars devant le château, qui aurait capitulé le 8 avril.
Ceci viendrait corroborer l'opinion que j'exprime d'une erreur de date dans le texte de l'auteur arabe.
Le second gouverneur musulman paraît avoir été l'émir Seïl-ed-din-Balban, dont nous avons déjà parlé au sujet de sa tentative infructueuse contre Margat en l'an 1280.
Le Krak semble avoir servi d'arsenal aux infidèles durant les dernières années de la guerre contre les Francs.
Sources : Rey (Emmanuel Guillaume), Etude sur les monuments de l'architecture militaire des croisés en Syrie et dans l'Ile de Chypre. Paris, Imprimerie Nationale M. DCCC. LXXI.